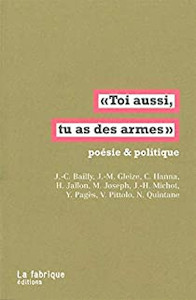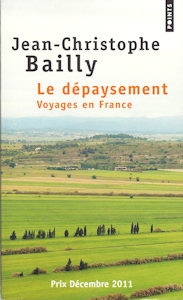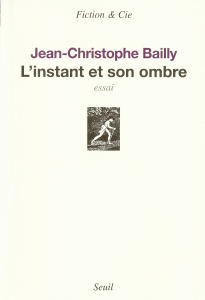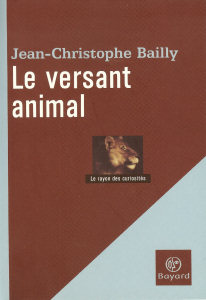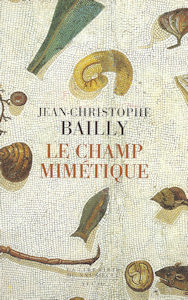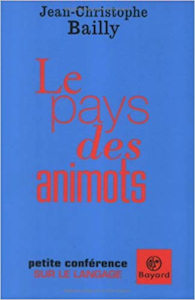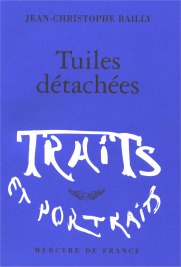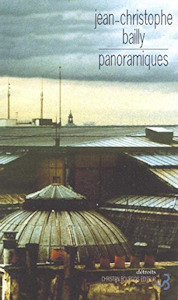JEAN-CHRISTOPHE BAILLY
Un arbre en mai
"Qu’est-ce à dire ? Un essai, un essai sur Mai 68 ou sur la distance qui nous en sépare ? Non, pas cela, pas cette fois-ci. Une visite, plutôt. Ou un retour vers l’amont, c’est-à-dire aussi vers la jeunesse et vers le temps perdu, vers un nœud qui se fit à un moment donné dans ce temps, et par lequel nous eûmes l’impression de basculer dans un autre temps, appelé lui aussi à se perdre, mais plus lentement et selon d’autres rythmes et d’autres textures."
"Nous voulions exister, nous voulions que la joie d’exister qui était la nôtre soit proférée et connue, qu’elle soit reçue comme un droit : par-delà toutes les explications qui les inscrivent dans des logiques purement politiques ou économiques, les événements de Mai resteraient incompréhensibles si l’on ne faisait pas la part, en eux, de cette pure violence de sursaut, de cette éruption quasi biologique d’une jeunesse prenant ingénument conscience de sa force."
"Mai 68 fut une convergence, c’est comme si des milliers de petites rigoles avaient abouti au même point, formant un lac d’impatience qui ne pouvait que déborder."
" Non, c’était plutôt comme un état et, il faut le dire, un état plutôt heureux, fait de vitesses et d’associations d’idées, d’exemples et d’échos. Ce que je refusais, c’était la vie routinière et toute tracée qu’on nous peignait comme notre avenir, j’avais envie d’être ébloui et, confusément, il me semblait qu’on cherchait davantage à nous aveugler, à faire de nous des êtres raisonnables et soumis."
"Un demi-siècle (et non plus seulement trente-six ans comme lorsque j’écrivis ces pages), telle est aujourd’hui la distance temporelle qui nous sépare de Mai 68, que vingt-trois ans seulement séparent de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que je le rappelle à un moment du texte. Au vertige que donnent de telles indications, il faut ajouter, comme justification à la publication de ces pages, le désir de parer tant bien que mal à la déferlante de livres et de témoignages que ne manquera pas d’entraîner cet anniversaire, dans un pays qui est si friand en commémorations. Cette fièvre de retours, sans doute ne puis-je ici que la précéder, mais en ayant tenté, et ce sera ma présomption – ou mon excuse – de l’avoir quand même esquivée."