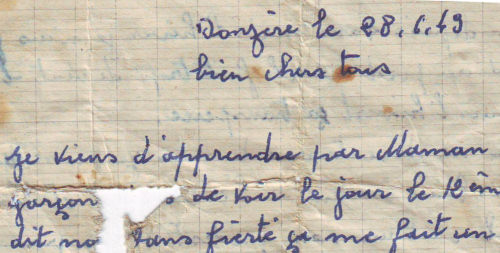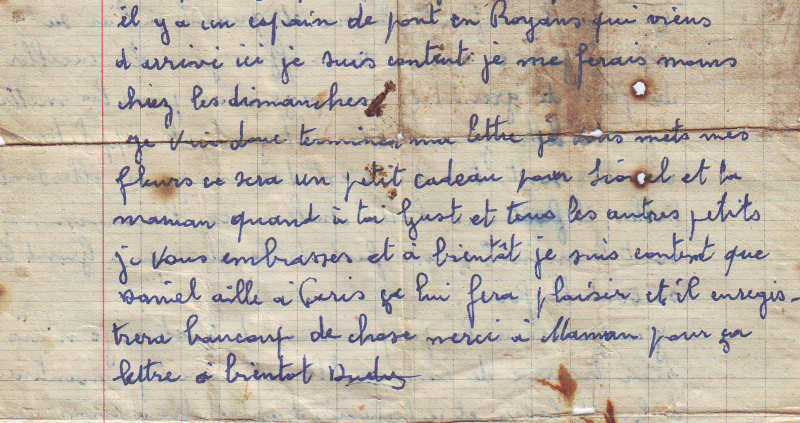Il se propage quelquefois par la ville comme un froissement d’étoffe.
Une manière de frisson
dont l’eau lasse et lente avec langueur ondule
murmurait Charles Morice*, mais l’on ignore qui, de cette femme en larmes, laquelle s’engouffre dans une voiture, laissant choir sur la chaussée l’étole qui ceignait ses épaules, de cet homme, cet enfant encore, l’un et l’autre anxieux et qui tentent de nouer leurs mouchoirs au souvenir presque effacé déjà des jours où ils avaient imaginé changé le monde, oui, l’on ignore qui saura s’envelopper au matin de la brume avec quoi la cité se réveille : l’aube n’est bien souvent qu’un peu du drap chiffonné de la nuit.
*
On ne visite pas Saint-Étienne.
Il faut y prendre lentement la mesure d’un temps qui s’estompe ou s’éloigne, s’immobilise un instant, disparaît.
Suivre au hasard l’une des rues conduisant au « Crêt des 6 soleils » et regarder, d’une butte adjacente, légèrement à l’écart quand on se promène dans le parc de Montaud, les longs voiles de fumée grise qui pendent aux toitures des usines puis, rêvassant, tournant le dos à l’étroite vallée, sourire aux ultimes collines qui jalonnent les abords de la plaine du Forez.
Reprendre son chemin.
Retrouver, après les avoir oubliés ne serait-ce qu’une minute, les terrils jumeaux du puits Couriot, où est installé le musée de la mine.
Reconnaître à nouveau les aciéries, le stade Geoffroy-Guichard, la grande artère enfin, et le Guizay, Côtes Chaudes, les différentes zones périphériques, ressentant comme jamais, quand on né dans les parages — quitte à s’en défendre —, un sentiment très fort, de lien, d’appartenance, une sorte d’identité, c’est ça :
— Je suis d’ici, je suis bien d’ici
grogne-t-on, de ces scories, cette clarté, pâle, maladive, qui s’encrasse à travers les verrières d’établissements dont on ne déchiffre qu’avec chance :
MA SON RIVOI E
Rub Passem en gros
la raison sociale peinte sur de sombres murs de grès ou de brique.
Tout est trop loin. Trop vieux.
Les manufactures. Les logements ouvriers. Le Furan qui coulait là-bas, dans le quartier de Valbenoîte où, les gars des forges, les mineurs, même, qui furent gens de silence, en conçurent une drôle de tendresse :
— Tissent des « faveurs » au kilomètre, là-d’dans !
se concentra l’industrie textile.
Du coup, s’il ne situe pas toujours avec exactitude la rue des Frères Chappe — de l’Artisanat et du Concept moins encore : l’auteur de cette trouvaille, récente, siégeant probablement au Conseil municipal, le démasquer ne devrait pas être tâche trop ardue — le Stéphanois, c’est à cette singulière culture qu’on le flaire, guidera les yeux fermés n’importe quel quidam recherchant à pied, à cheval ou en automobile celle des Passementiers.
Il n’en méprise pas pour autant, par contraste, goût du paradoxe ou snobisme prolétarien, le couperet rectiligne de la rue de la République, où j’habite et que je distingue maintenant, tellement proche, la place de l’Hôtel de Ville pas davantage, que je devrais traverser tout à l’heure, saluant d’un geste discret les deux colosses de bronze qui représentent, l’un, la Métallurgie, la Rubanerie le second, chaque allégorie, chaque divinité, masculine quant au Zeus athlétique trônant en lieu et place de l’Héphaïstos attendu — un boiteux, devant la mairie, eût sans doute fait mauvaise figure —, féminine quant à sa voisine, rappelant à l’éventuel touriste qu’ici rien n’aurait existé sans l’exploitation de la force de travail.
*
Partout, derrière les façades bourgeoises, qu’ils prolongent, invisibles depuis la chaussée, les trottoirs, ce sont de hauts immeubles, percés de hautes fenêtres qui s’ouvrent sur des cours, quelques-unes pavées, aujourd’hui comme au XIXe siècle, que l’on aperçoit ou fréquente au hasard des traboules et des portes cochères.
Domaines jadis bruissant, bourdonnant d’une activité dont on percevait la rumeur d’assez loin — le même battement sourd, alors, jusque dans les appartements, le même rythme, de train, mais c’était seul voyage, l’aller, le retour, l’aller, le retour, lequel berça bien des gosses dont les parents, leur journée faite, s’attelaient le soir au métier à tisser familial —, domaines cachés, relégués au fond des impasses, le dernier étage abritant en général des bureaux ou les magasins de stockage : j’y déniche, en cas de travaux, des boîtes contenant du ruban, les catalogues de somptueux tissus profanes ou ecclésiastiques, sans rire, ecclésiastiques :
Pour chanter Veni creator
Il faut une chasuble d’or
des bobines de fils plus fins que des cheveux, plus souples, plus résistants aussi, des peignes et des broches, des velours mités, et du coutil, des calicots, de la toile de coton, du crêpe, de l’indienne.
*
« La rubanerie, qui est une des industries spécifiquement stéphanoises, a eu, au XIXe et au XXe siècles, des alternatives de prospérité et de crises », remarquait Louis Dorna dans son Histoire de Saint-Étienne**. Passant sur les troubles sociaux qu’il dédaigne ou minimise, notre auteur expédie la brève Commune locale, le drapeau tricolore triomphant aussitôt, selon lui, de l’infâme chiffon rouge.
Ouf ! Le capital l’avait échappé belle !
On allait enfin s’amuser.
Vivre. Boire des alcools délicats. Valser sous de grands lustres sans se soucier des guerres lointaines ni de celle qui commencerait un mois d’août :
— Mais vous n’y pensez pas, allons, allons, je vous en prie, il faut raison garder
le sang n’éclabousse qu’à peine taffetas et mousselines dans les boudoirs où l’on chuchote les vers d’Anna de Noailles :
Dans le jardin, sucré d’œillets et d’aromates,
Lorsque l’aube a mouillé le serpolet touffu,
Et que les lourds frelons, suspendus aux tomates,
Chancellent, de rosée et de sève pourvus,
Je viendrai, sous l’azur et la brume flottante […]
tandis qu’un jeune pianiste interprète en sourdine l’une de ses plus gracieuses pièces.
Il fait beau.
Il fait toujours beau parmi les rubans et les galons, les cordonnets, les laisses, les embrasses.
Une jeune fille, à dessein, oublie son mouchoir sur une chaise cependant que sa mère, qui sourit, lasse, une ride ingrate au coin des lèvres, regarde sa beauté s’éteindre ou briller encore malgré tout dans les bulles du vin de Champagne.
On lit du Léon Daudet.
Du Camille Mauclair comme du Charles Maurras : la vulgarité, parfois, n’est que la fatigue, l’ombre ou le désenchantement d’une certaine élégance.
*
Or cette grâce, et dans le vêtement même cette façon d’insolence ou de « chien », disait-on, qui ne sont ni de mode ni d’une caste mais, au plus brûlant des émois, le frisson que j’évoquais au départ, chez nulle autre on ne les rencontra davantage que chez cette femme dont la silhouette se découpe encore dans nos imaginations sur fond de barricade, la voici qui surgit, « vêtue d’une mirifique robe rouge, la ceinture crénelée de pistolets », rapportera Lissagaray, lequel en fut frappé — « notons la toilette toute de velours noir », insiste-t-il en d’autres circonstances —, qui s’offre, se refuse et frémit comme une flamme toujours vive sur les décombres du Paris de 1871, libre, insurgée.
« Grande, les cheveux d’or, admirablement belle […], soignant les blessés, trouvant des forces incroyables dans son cœur généreux », écrit encore Lissagaray, on la nommait : « la Dimitrieff », sans trop savoir qui elle était.

Elle va, semble flotter sur la Commune, échappe de peu à la répression, rejoint son mari, qui meurt subitement, à Moscou, se soustrait à la justice tsariste avant de disparaître — certains jurèrent l’avoir vue au bras d’un amant d’une quelconque canaille, en Sibérie, au Kamtchatka, à Saint-Petersbourg ou Genève, du côté d’Odessa, à Chypre, à Venise : les révolutions seraient bien prudes, bien frigides, peut-être, sans ces inconnues toutes de fièvre qui ne font que passer.
*
Je veux croire que les robes de la Dimitrieff, la rouge, la noire, furent ornées de fanfreluches tissées à Saint-Étienne et que ces couleurs, de feu ou de sang, de deuil et de crâne sédition, s’allumaient d’être l’une à l’autre mêlées quand sur les barricades les femmes, uniquement les femmes, défiaient la soldatesque ameutée par Versailles.