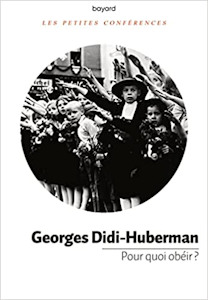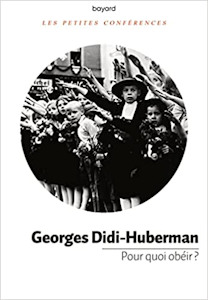Tout autre était la proposition de Walter Benjamin, que nous reprenons ici à notre compte : « organiser le pessimisme » dans le monde historique en découvrant un « espace d'images » au creux même de notre « conduite politique », comme il dit. Cette proposition concerne la temporalité impure de notre vie historique, qui n'engage ni destruction achevée ni début de rédemption. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre la survivance des images, leur immanence fondamentale : ni leur néant, ni leur plénitude, ni leur source d'avant toute mémoire, ni leur horizon d'après toute catastrophe. Mais leur ressource même, leur ressource de désir et d'expérience au creux même de nos décisions les plus immédiates, de notre vie la plus quotidienne.
[...]
Les lucioles, il ne tient qu'à nous de ne pas les voir disparaître. Or, nous devons, pour cela, assumer nous-mêmes la liberté du mouvement, le retrait qui ne soit pas repli, la force diagonale, la faculté de faire apparaître des parcelles d'humanité, le désir indestructible. Nous devons donc nous-mêmes - en retrait du règne et de la gloire, dans la brèche ouverte entre le passé et le futur - devenir des lucioles et reformer par là une communauté du désir, une communauté de lueurs émises, de danses malgré tout, de pensées à transmettre. Dire oui dans la nuit traversée de lueurs, et ne pas se contenter de décrire le non de la lumière qui nous aveugle.
Nous ne vivons pas dans un monde, mais entre deux mondes au moins. Le premier est inondé de lumière, le second traversé de lueurs. Au centre de la lumière, nous fait-on croire, s'agitent ceux que l'on appelle aujourd'hui, par cruelle et hollywoodienne antiphrase, les quelques people, autrement dit les stars - les étoiles, on le sait, portent des noms de divinités - sur lesquelles nous regorgeons d'informations le plus souvent inutiles. Poudre aux yeux qui fait système avec la gloire efficace du « règne » : elle ne nous demande qu'une seule chose, et c'est de l'acclamer unanimement. Mais aux marges, c'est- à-dire à travers un territoire infiniment plus étendu, cheminent d'innombrables peuples sur lesquels nous en savons trop peu, donc pour lesquels une contre-information apparaît toujours plus nécessaire. Peuples-lucioles quand ils se retirent dans la nuit, cherchent comme ils peuvent leur liberté de mouvement, fuient les projecteurs du « règne », font l'impossible pour affirmer leurs désirs, émettre leurs propres lueurs et les adresser à d'autres.