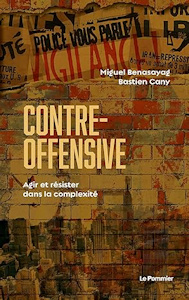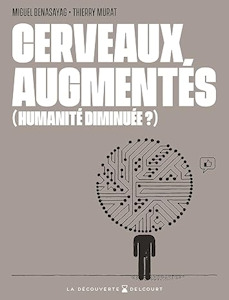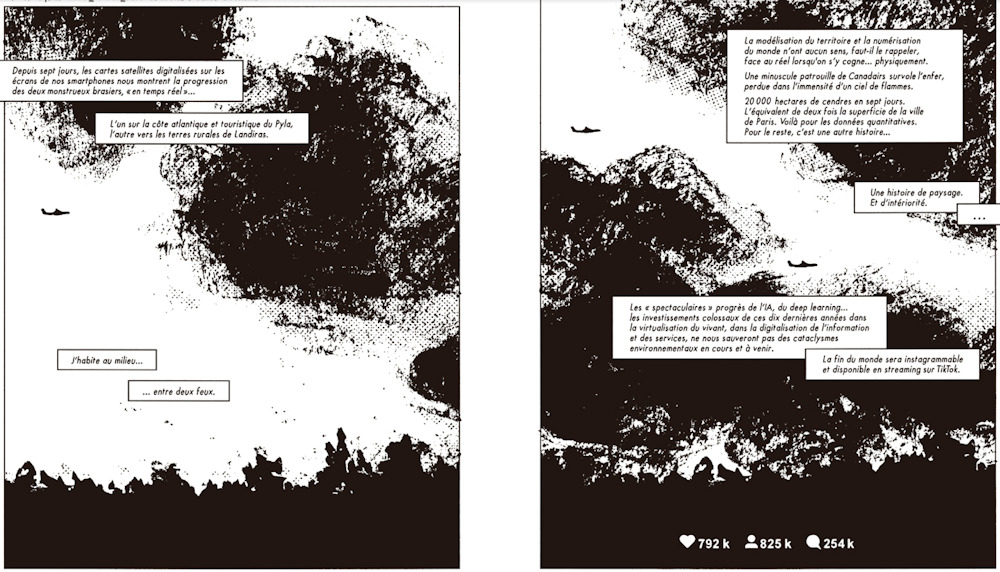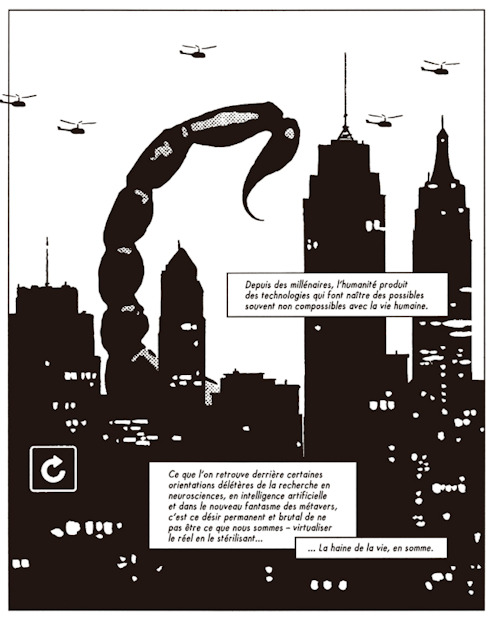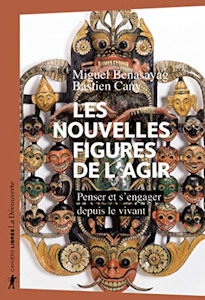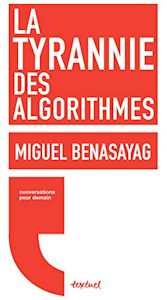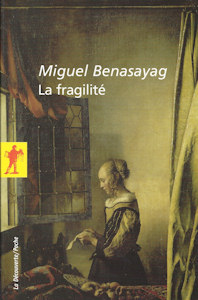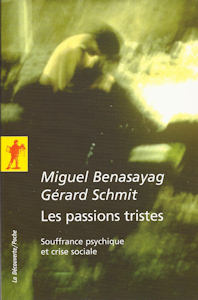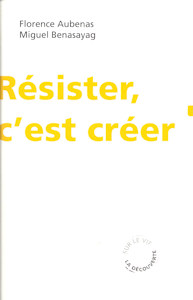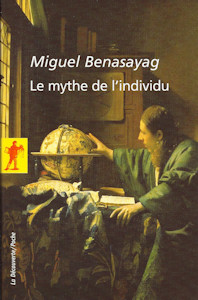La première de ces doctrines correspond à ce que nous pourrions appeler la position hypermoderne. « Sauvons la planète, soyons davantage capitalistes » : tel pourrait être le slogan de ce nouveau technocratisme, sorte d’amalgame entre l’idéologie de la Silicon Valley et la doxa néolibérale, qui prêche pour une accélération sans limites de l’innovation technologique, véritable ersatz du progrès, dont la puissance serait en mesure non pas de régler les graves problèmes de notre temps, mais de les enjamber pour les dépasser.
La deuxième prend en considération la trajectoire actuelle de destruction, reconnaît la nécessité de préserver la nature, envisagée à l’aune de ses « services écosystémiques », et prône un ajustement de notre agir pour garantir un prétendu « développement durable ». Pour cette thèse aujourd’hui archidominante au sein des États occidentaux, il s’agit de trouver les bases objectives et scientifiques d’un nouveau modus vivendi avec l’« environnement » tout en continuant de faire comme avant : exploiter les ressources, produire, consommer, sans jamais remettre en cause ni les structures de pouvoir, ni l’idée d’une croissance infinie, ni la croyance en un progrès ascensionnel qui redonnerait un sens à nos actes.
La troisième position s’inscrit dans le sillage du vaste courant de l’écologie humaniste. Ce mouvement politique et historique, contrairement aux deux précédents, a non seulement identifié et compris l’ampleur et la radicalité du problème, mais il a également, dans un effort théorique et pratique, questionné les modes de vie occidentaux tout en explorant des alternatives. En s’attaquant à l’anthropocentrisme occidental, l’écologie politique perpétue certes une longue tradition philosophique de critiques envers le paradigme européen de la séparation, mais elle est la première à en faire une force politique et sociale. Dans cette perspective, la régulation passe par une rupture avec le dualisme cartésien et l’élaboration de nouvelles alliances avec le vivant depuis un point de vue décentré où la réalité est considérée depuis l’écosystème. C’est l’influence de ce type d’approche qui a récemment permis l’extension de la notion de sujet de droit à des non-humains en tant qu’expression de la multiplicité des vecteurs qui composent nos milieux.
Enfin, la quatrième voie, que nous qualifions de décoloniale, partage avec l’écologie politique cette hypothèse lourde qui postule que la production du commun n’est pas le monopole de l’humain. Elle s’en distingue toutefois par une différence fondamentale : les points de vue décoloniaux ne considèrent pas que l’homme soit un vecteur du système parmi d’autres, précisément parce que cette figure historique et culturelle n’existe pas en dehors du monde colonial. Dans les cosmologies non modernes, l’humain se conçoit et s’expérimente comme une multiplicité agencée à d’autres multiplicités. Cela n’implique évidemment pas que l’individu, en tant que singularité, ne soit dans ces cultures qu’une pure illusion. Mais celui-ci se perçoit et agit depuis une intériorité tissée d’extériorité. Loin de représenter une unité étanche et autonome, la personne se voit et existe concrètement comme la manifestation des liens qui la composent. Pour elle, il n’est pas question de décentrage de l’humain, car cette entité ouverte n’est jamais envisagée comme une partie séparée de l’ensemble qui la constitue. C’est dans ce mode d’être et d’agir que réside aujourd’hui la radicalité de la position décoloniale. Celle-ci ne repose pas sur une opposition guerrière à l’Occident, mais bien sur l’expression en pure positivité de ce rapport au monde. Si la décolonisation implique effectivement une déconstruction des archétypes occidentaux, ces processus ne se structurent pas dans un projet strictement contre, mais dans des luttes pour l’émancipation, la justice sociale et écologique. "
" Dès lors, au nom de quoi résister ? Dans nos sociétés orphelines de la grande promesse émancipatrice, cette question devient éminemment centrale. S’il est plus que jamais nécessaire de passer à une véritable contre-offensive, celle-ci ne peut plus se constituer en un projet contre pour lequel vaincre l’ennemi est la raison suffisante. Cela serait une erreur fatale de reproduire les figures classiques de l’affrontement binaire et de la verticalité propres au mode d’émancipation occidental, qui ne font qu’entretenir le schéma colonial de domination. Dans un monde où les rapports de force apparaissent brouillés, cette résistance doit s’axer dans la création de nouveaux possibles, ici et maintenant, en renonçant à toute promesse métaphysique d’une justice finale. "
"Comme nous le verrons plus loin, l’invention de la race, comme toutes les autres grilles de classification coloniale, relève de cette supercherie qui consiste à isoler un élément réellement existant dans la multiplicité de la personne pour fabriquer une étiquette disciplinaire. "
"Individu du manque permanent et de l’incomplétude, le sujet moderne ne se saisit lui-même qu’en pur projet. "
"Notre époque voit ainsi la convergence de deux mouvements autonomes mais intriqués, qui redéfinissent les nouveaux contours de notre être au monde. D’une part, l’expérience sans cesse croissante et malheureuse pour les humains de la perte de leur capacité d’agir. La figure de l’homme destiné à prendre possession du réel éprouve au quotidien la tristesse de son impuissance face à un monde qui lui apparaît toujours plus obscur et chaotique. D’autre part, rien ne semble pouvoir arrêter le développement exponentiel du monde algorithmique et de ce que notre époque a mal nommé l’intelligence artificielle. À tel point que cette nouvelle dimension des hautes technologies paraît se comporter comme une nouvelle espèce en rivalité avec les autres et en particulier avec l’humain ."
"Précisons tout de suite que derrière l’hypocrisie du développement durable et de la croissance verte, l’Occident poursuit plus que jamais dans les pays dits « périphériques » ses programmes agressifs d’exploitation des ressources minières et agricoles par l’extractivisme et l’agriculture intensive. Une surexploitation aux conséquences écologiques tragiques et dont les bénéfices échappent toujours aux populations locales."
"On ne peut plus s’indigner et disserter sur la fin du monde et la montée des pouvoirs réactionnaires et, dans le même temps, continuer à croire en ce conte de fées disciplinaire qui prétend que tout pourrait s’arranger par le dialogue et la mesure. L’adhésion au rêve mortifère d’une société pacifiée et policée se fait toujours au prix de cette complicité avec l’horreur qui nous pousse à détourner le regard devant l’écrasement de la vie. L’injonction à mourir sans faire de bruit n’est plus supportable. "
"Le grand piège pour la résistance sera toujours d’arrêter d’être ce qu’elle est pour répliquer à l’ennemi. De ce point de vue, la pire des réponses symétriques est celle qui consiste à endosser le rôle du barbare auquel le pouvoir veut systématiquement réduire ses opposants. Quand la lutte devient terrorisme, elle n’est plus résistance. Elle a déjà trahi les idéaux qu’elle prétend défendre. La supériorité éthique et ontologique qui fonde toute révolte face à l’oppression réside dans son asymétrie avec la répression. Or, le terrorisme, en se constituant comme l’égal du pouvoir contesté, devient lui-même une force de domination. Le terroriste est réactionnaire, précisément parce qu’il opère depuis le point de vue du pouvoir. Il pense et agit depuis une hyperverticalité dans laquelle la population n’est plus qu’un moyen au service de ses fins. À chaque fois que la résistance se structure en spécularité avec le pouvoir tyrannique, c’est toujours, au bout du compte, la tyrannie qui vaincra. "
Miguel Benasayag sur Radio-Univers